L’approche des soins tenant compte des traumatismes s’applique à l’intervention autant qu’au niveau organisationnel. De la prévention au traitement, elle s’intéresse à la façon dont les traumatismes peuvent affecter une personne ainsi que sa réaction à l’aide qui lui est offerte. Reconnaître la prévalence des traumatismes ainsi que les effets qu’ils peuvent avoir sur une personne et se servir de ces connaissances pour moduler nos interactions sont des éléments clés de cette approche. On peut améliorer notre compréhension des traumatismes en impliquant les étudiants et les étudiantes dans leur processus de traitement de manière collaborative, en s’appuyant sur leurs forces et en misant sur l’acquisition d’habiletés.
La relation entre les services de police et certaines populations étudiantes
Les agents de sécurité ou de police du campus et les policiers locaux font partie des acteurs qui peuvent aider les étudiants ou les étudiantes en situation de crise en santé mentale. Ils sont souvent présents lorsqu’une personne est à risque de porter atteinte à sa propre sécurité ou à celle des autres. Toutefois, ce n’est pas toutes les populations étudiantes qui ont une bonne relation avec la police ou les services apparentés. Plusieurs groupes de personnes, et celles auxquelles vous offrez de l’aide peuvent en faire partie, ont historiquement eu avec la police des relations conflictuelles qui ont eu des retombées défavorables. Cet historique doit être pris en considération, en particulier quand vous cherchez à orienter la personne en crise vers les ressources appropriées. Ainsi, certaines collectivités ont commencé à changer leur manière de répondre aux crises en santé mentale pour faire appel à des unités de crise mobiles plus souvent qu’aux services de police. La Ville de Toronto, en Ontario, a actuellement un tel projet pilote d’unité de crise mobile.
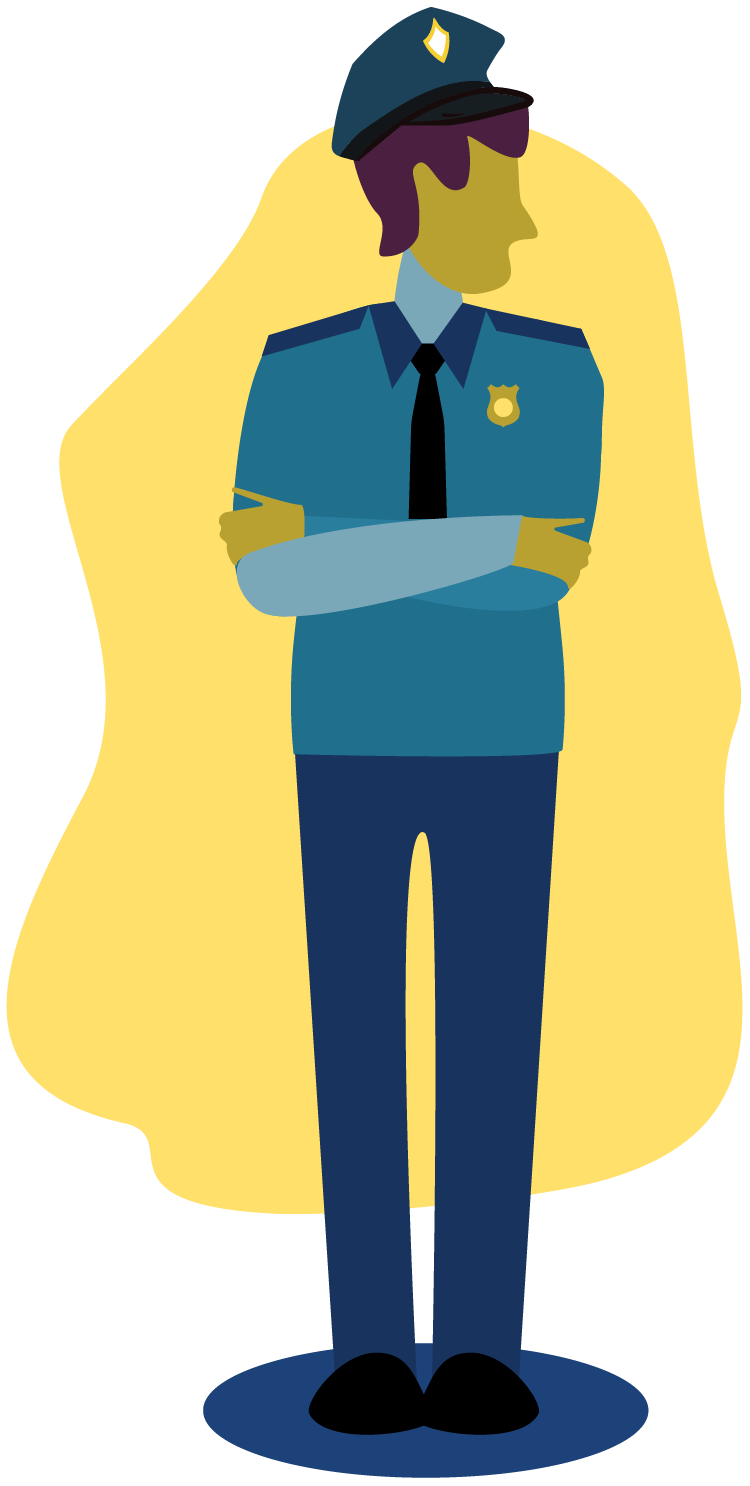 Il est également important de reconnaître le déséquilibre de pouvoir existant dans la relation entre les services de sécurité ou de police et la population étudiante : le rôle des premiers leur confère des pouvoirs que les étudiants n’ont pas. Cette dynamique de pouvoir peut donc se manifester dans leurs interactions. Selon la situation, les agents de sécurité ou de police peuvent se voir conférer le droit de prendre des décisions concernant la personne, que celle-ci soit d’accord ou non. Il est par exemple arrivé qu’ils passent les menottes à la personne en crise ou l’obligent à s’en aller du campus. En raison de ce déséquilibre de pouvoir ainsi que d’expériences passées avec les services de sécurité ou de police, certains se sentent méfiants et réticents à leur demander de l’aide.
Il est également important de reconnaître le déséquilibre de pouvoir existant dans la relation entre les services de sécurité ou de police et la population étudiante : le rôle des premiers leur confère des pouvoirs que les étudiants n’ont pas. Cette dynamique de pouvoir peut donc se manifester dans leurs interactions. Selon la situation, les agents de sécurité ou de police peuvent se voir conférer le droit de prendre des décisions concernant la personne, que celle-ci soit d’accord ou non. Il est par exemple arrivé qu’ils passent les menottes à la personne en crise ou l’obligent à s’en aller du campus. En raison de ce déséquilibre de pouvoir ainsi que d’expériences passées avec les services de sécurité ou de police, certains se sentent méfiants et réticents à leur demander de l’aide.
Une perception erronée des pouvoirs détenus par les agents de sécurité du campus peut aussi jouer dans cette réticence. Certains peuvent croire à tort que ceux-ci peuvent les expulser de l’université ou du collège ou encore qu’ils portent des armes meurtrières lors de leurs interventions. Une consultation d’étudiants et d’étudiantes confirme cette compréhension erronée et la méfiance qui en découle (University of Toronto – The Review of the Role of Campus Safety Services in Student Mental Health Crises Review Panel, 2021).
 En plus des interactions personnelles qu’ont les agents de sécurité ou de police avec les étudiants et les étudiantes, il importe de souligner l’aspect systémique de leurs relations avec différents groupes. Les lois créées par le gouvernement et les histoires rapportées dans les médias ont amplifié un lien qu’on présumait entre certaines populations et des comportements criminels (Maynard, 2017). Ces lois ont donné une bonne marge de manœuvre aux policiers pour choisir quels groupes de personnes seraient surveillés. Dans les populations qui font l’objet d’une surveillance policière accrue, il y a une plus grande probabilité d’interaction avec la police, ce qui augmente en conséquence les risques de vivre avec celle-ci des expériences négatives de même que de faire l’objet d’accusations et de condamnation ainsi que d’être incarcéré (Maynard, 2017). Par exemple, la Loi sur les Indiens (qui n’a été abrogée qu’en 1985) interdisait la vente et la consommation d’alcool aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis); la loi concernant l’opium adoptée en 1908 visait particulièrement les ouvriers chinois travaillant à la construction du Chemin de fer Canadien Pacifique; enfin, la police procède à davantage de contrôles d’identité au sein des communautés noires (Maynard, 2017).
En plus des interactions personnelles qu’ont les agents de sécurité ou de police avec les étudiants et les étudiantes, il importe de souligner l’aspect systémique de leurs relations avec différents groupes. Les lois créées par le gouvernement et les histoires rapportées dans les médias ont amplifié un lien qu’on présumait entre certaines populations et des comportements criminels (Maynard, 2017). Ces lois ont donné une bonne marge de manœuvre aux policiers pour choisir quels groupes de personnes seraient surveillés. Dans les populations qui font l’objet d’une surveillance policière accrue, il y a une plus grande probabilité d’interaction avec la police, ce qui augmente en conséquence les risques de vivre avec celle-ci des expériences négatives de même que de faire l’objet d’accusations et de condamnation ainsi que d’être incarcéré (Maynard, 2017). Par exemple, la Loi sur les Indiens (qui n’a été abrogée qu’en 1985) interdisait la vente et la consommation d’alcool aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis); la loi concernant l’opium adoptée en 1908 visait particulièrement les ouvriers chinois travaillant à la construction du Chemin de fer Canadien Pacifique; enfin, la police procède à davantage de contrôles d’identité au sein des communautés noires (Maynard, 2017).
La recherche a complètement réfuté les stéréotypes négatifs sur lesquels se sont basées la création et l’application de plusieurs lois; elle a par ailleurs démontré la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice. En voici quelques exemples :
- Par le passé, on avait associé crime et populations immigrantes et migrantes, en particulier chez les jeunes. Toutefois, Sécurité publique Canada a démontré que le taux de « comportements délinquants » était plus faible chez les jeunes nés hors du Canada que chez ceux qui y sont nés (Sécurité publique Canada, 2012).
- Il est également important de souligner le nombre grandissant d’étudiants internationaux et leur relation particulière aux services policiers. Plusieurs viennent de pays où la police détient des pouvoirs différents de ceux qu’elle a ici, ce qui peut entraîner une interprétation différente de son rôle.
- Même si les Autochtones constituent environ 5 % de la population canadienne, ils représentent presque 25 % des personnes incarcérées (Sapers, 2015).
Il est également arrivé des incidents violents lors d’interventions de la police dans des situations impliquant des personnes de certaines identités ou qui vivaient une crise en santé mentale. Effectivement, des études ont démontré une surreprésentation de certaines minorités, en particulier issues de groupes racisés, dans les cas où l’utilisation de la force par la police a entraîné un décès. De même, le risque que les policiers fassent une utilisation de la force menant au décès est plus grand lorsqu’ils interviennent avec des personnes aux prises avec des problématiques de santé mentale (Gillis, 2015; Chan and Chun, 2014). Il existe malheureusement plusieurs exemples de ces cas. En voici quelques-uns sur lesquels vous voudrez peut-être en savoir plus :
- Regis Korchinski-Paquet — Regis, une femme de 29 ans, était aux prises avec des problématiques de santé mentale. Lors d’une altercation physique qui s’est produite dans le domicile familial, sa famille a demandé l’aide de la police. Regis a été tuée lors de l’interaction avec les policiers.
- Ejaz Chourdry – Ejaz, 62 ans, était atteint de schizophrénie. Sa fille a téléphoné à la police pour une vérification de son bien-être parce qu’il n’avait pas pris sa médication. Ejaz a été tué lors de son interaction avec les policiers.
- Guy Ritchie
Guy, 30 ans, avait des problématiques de santé mentale. En chemin vers la pharmacie, il a eu une interaction avec la police lors de laquelle il a été tué.
Ces interactions négatives causent du tort non seulement aux personnes impliquées, mais aussi à toute la communauté dont elles sont issues. Une recherche effectuée par l’American Psychological Association a démontré que le profilage effectué par la police peut causer du stress posttraumatique et d’autres troubles liés au stress (Ontario Human Rights Commission cité dans Maynard, 2017).
À plusieurs endroits, les collectivités délaissent le modèle d’intervention de crise en santé mentale dans lequel la police jouait un rôle central. Plusieurs ont souligné que du personnel en santé mentale bien formé était en mesure de gérer les crises lorsqu’il n’y avait pas de menace de violence immédiate. Ce point de vue a amorcé un mouvement prônant ainsi l’utilisation d’unités de crise mobiles plutôt que l’intervention policière. Les établissements d’enseignement postsecondaire peuvent bénéficier des apprentissages faits par les collectivités et adapter ce nouveau modèle d’intervention de crise aux besoins de leur campus.

